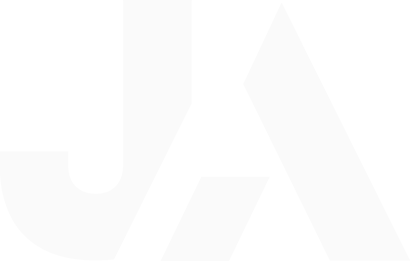Le testament authentique est un acte rédigé par un notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire. Il garantit une pleine sécurité juridique : absence d’erreur de forme, conservation et exécution assurées. Ce type de testament exprime les volontés du testateur avec valeur probante renforcée.
L’usufruit est un droit réel qui permet à une personne (l’usufruitier) de jouir d’un bien appartenant à autrui et d’en percevoir les revenus (loyers, intérêts, etc.), sans en être propriétaire. Le nu-propriétaire conserve la propriété du bien. L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier ou à la fin du terme prévu.
La devise du notariat est « Lex est quod notamus », que l’on traduit par « Est droit ce que nous écrivons ». Elle exprime la force authentique de l’acte notarié : ce que le notaire rédige a valeur de preuve absolue et s’impose aux tiers, sauf décision contraire d’un juge.
Cette devise illustre le rôle du notaire, officier public investi par l’État, garant de la sécurité juridique des actes de la vie courante : ventes immobilières, contrats de mariage, successions, donations… Elle rappelle que la parole du notaire engage l’autorité de l’État et confère une authenticité incontestable aux actes.
Au-delà de la formule latine, la devise reflète la mission essentielle du notariat : assurer la neutralité, la confiance et la protection des familles et des entreprises.
👉 La devise notariale incarne donc la raison d’être de la profession : faire du droit écrit une garantie de justice et de sécurité juridique.
Le compte courant d’associé est une avance en trésorerie réalisée par un associé au profit de sa société. Concrètement, l’associé prête de l’argent à la société, sans augmenter le capital social. Ce mécanisme est courant en SCI, SARL ou autres structures, car il permet de financer rapidement l’activité sans recourir à un prêt bancaire.
Le compte courant d’associé peut être rémunéré (versement d’intérêts) ou non, selon la convention prévue. L’associé devient alors un créancier de la société et peut, sous conditions, demander le remboursement de ses avances. Toutefois, ce remboursement ne doit pas mettre en péril la trésorerie de l’entreprise.
Cet outil est apprécié pour sa souplesse : il facilite la gestion financière, optimise la fiscalité et sécurise les relations entre associés.
👉 En résumé, le compte courant d’associé est un instrument de financement interne essentiel à la vie des sociétés.
La SCI (Société Civile Immobilière) et la SARL (Société à Responsabilité Limitée) répondent à des objectifs différents.
La SCI est une société civile dédiée à la gestion d’un patrimoine immobilier : acheter, louer (nu), transmettre un bien. Elle facilite la transmission familiale et l’organisation de l’indivision. En revanche, elle ne peut pas exercer une activité commerciale (comme la location meublée) sous peine de requalification. Les associés restent responsables indéfiniment des dettes sociales, chacun à proportion de ses parts.
La SARL, au contraire, est une société commerciale adaptée à l’exploitation d’une activité économique (commerce, artisanat, services, location meublée). Elle offre une responsabilité limitée des associés à leurs apports, protège le patrimoine personnel et peut être créée seule (EURL) ou à plusieurs.
👉 En résumé : la SCI sert à détenir et gérer un bien immobilier, tandis que la SARL sert à exploiter une activité commerciale.
Le logement de la famille, protégé par l’article 215 alinéa 3 du Code civil, correspond à la résidence principale du couple marié, qu’il soit propriétaire ou locataire. Ce bien bénéficie d’une protection légale renforcée : aucun des époux ne peut le vendre, le donner, l’hypothéquer ou encore résilier le bail sans l’accord de l’autre.
L’objectif est de préserver la stabilité du foyer et de protéger les intérêts de la famille. Cette règle empêche qu’un seul époux compromette la sécurité du logement familial, élément essentiel de la vie commune.
Concrètement, cette protection s’applique à tout domicile conjugal servant de résidence principale, peu importe qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement, ou d’un bien loué.
👉 En résumé, le logement familial est un bien juridiquement sanctuarisé, garantissant la sécurité juridique et la protection de la vie familiale.
L’obligation légale de débroussaillement est une règle de prévention incendie imposée aux propriétaires de terrains situés à proximité des forêts, garrigues ou landes. Elle consiste à éliminer les broussailles, tailler la végétation et maintenir une zone sécurisée autour des maisons et constructions. En principe, le débroussaillement doit être réalisé dans un rayon de 50 mètres autour des habitations et de 10 mètres le long des voies d’accès, sauf prescriptions locales plus strictes.
Cette obligation permet de limiter la propagation du feu, de faciliter l’intervention des secours et de protéger les personnes et biens. Le non-respect entraîne des sanctions : amende jusqu’à 1 500 €, astreinte journalière et, en cas d’incendie, mise en cause de la responsabilité du propriétaire.
👉 Le débroussaillement est donc un geste de sécurité, de responsabilité et de protection collective.
En matière de succession ou de donation, chaque parent bénéficie d’un abattement légal de 100 000 € au profit de son enfant, renouvelable tous les 15 ans. Cela signifie qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € de ses deux parents, totalement exonérés de droits de donation ou de succession. Au-delà de cette somme, la part transmise est taxée selon le barème progressif applicable.
Cet avantage fiscal constitue un levier majeur de transmission patrimoniale : en planifiant des donations régulières, il est possible de réduire considérablement la fiscalité future et d’anticiper sereinement la succession.
Le notaire conseille et sécurise ces opérations, afin de respecter la réglementation, optimiser les abattements et assurer une répartition équilibrée du patrimoine familial.
Une servitude est une charge imposée à un bien immobilier (appelé « fonds servant ») au profit d’un autre bien (le « fonds dominant »). Elle limite l’usage d’un terrain au bénéfice d’un autre.
Exemple courant : la servitude de passage, qui permet à un propriétaire enclavé d’accéder à la voie publique en traversant le terrain voisin.
Les servitudes peuvent être légales (imposées par la loi) ou conventionnelles, c’est-à-dire créées par accord entre propriétaires. Dans ce cas, il est vivement recommandé de faire appel à un notaire, qui pourra rédiger un acte sur mesure et assurer sa publicité foncière.
Elles sont attachées au bien et non à la personne : elles continuent d’exister même en cas de vente.
Il est essentiel de les identifier lors d’un achat immobilier, car elles peuvent affecter l’usage ou la valeur d’un bien. Le notaire vérifie leur existence dans le cadre de la vente.
En France, la durée moyenne d’une succession est d’environ 6 à 12 mois. Ce délai peut varier selon la complexité du patrimoine, le nombre d’héritiers, ou encore l’existence de conflits ou de biens à l’étranger.
Les premières démarches (acte de notoriété, inventaire, demandes bancaires…) sont généralement accomplies dans les 2 à 3 premiers mois. Ensuite, l’établissement de la déclaration de succession doit être effectué dans un délai de 6 mois à compter du décès (12 mois en cas de décès à l’étranger).
En cas de biens immobiliers, la liquidation complète de la succession peut prendre plus de temps, surtout si une vente est nécessaire.
Un accompagnement rapide par le notaire et la fourniture complète des pièces peuvent accélérer considérablement le traitement du dossier.
Le bail rural à long terme est un contrat de location de terres agricoles conclu pour une durée minimale de 18 ans. Il peut aussi être conclu pour 25 ans ou plus, voire à durée illimitée (bail de carrière).
Il offre une grande stabilité au preneur (l’agriculteur), notamment en cas de transmission ou d’installation familiale. En contrepartie, il limite les possibilités de reprise anticipée par le bailleur.
Ce type de bail peut prévoir des clauses spécifiques (transmission à un descendant, conditions d’exploitation, loyer indexé…). Il ouvre également droit à des avantages fiscaux importants en matière de droits de donation ou de succession, sous conditions (article 793 du CGI).
Le bail doit être établi par écrit et peut être conclu devant notaire pour plus de sécurité juridique. Vous souhaitez plus de précision ? Prenez rendez-vous avec Maître Jérémy AUTHIER en cliquant ici.
La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) dispose d’un droit de préemption sur la vente de biens ruraux (terrains agricoles, bois, prairies, bâtiments d’exploitation…). Lorsqu’un propriétaire vend ce type de bien, la SAFER peut se substituer à l’acheteur pour acquérir le bien en priorité.
Objectif : favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, préserver les terres agricoles, lutter contre la spéculation et soutenir des projets d’aménagement rural cohérents.
Le notaire doit notifier la vente à la SAFER, qui dispose généralement d’un délai de 2 mois pour se prononcer. En cas d’exercice du droit de préemption, elle doit respecter les conditions de prix fixées, sauf négociation.
Le titre de « Maître » est une appellation honorifique réservée aux officiers publics du droit, comme les notaires, avocats ou huissiers de justice. Il marque à la fois le respect dû à leur fonction et leur rôle dans le service public de la justice.
Le notaire est en effet nommé par l’État et exerce une mission d’autorité : il authentifie les actes et leur confère une force probante et exécutoire. Appeler un notaire « Maître » souligne cette responsabilité juridique et son devoir d’impartialité dans chaque acte rédigé.
Ce titre est également un signe de confiance et de compétence, enraciné dans l’histoire du droit français, et rappelle que le notaire est un professionnel du droit au service de tous.
👉 Un conseil ? Une signature d’acte ? Parlez-en à votre notaire.
À quoi correspond la plaque dorée du notaire ?
La plaque dorée, appelée aussi panonceau, est un symbole officiel et réglementé qui signale l’implantation d’un office notarial. Elle est apposée à l’entrée du cabinet pour indiquer au public la présence d’un notaire en exercice, titulaire d’une charge confiée par l’État.
De couleur or, ce panonceau porte la mention « Notaire » accompagnée de l’emblème de la profession : la Marianne stylisée. Son installation est encadrée par des règles strictes, tant en matière de dimensions que de contenu, afin de garantir la neutralité et la dignité de la fonction.
Le panonceau atteste donc d’un service public de l’authenticité, où le notaire est compétent pour conseiller, authentifier et sécuriser les actes juridiques.
👉 En poussant la porte d’un office notarial, vous accédez à une expertise de confiance, encadrée par l’État.
La déclaration préalable de travaux est une autorisation d’urbanisme obligatoire pour certains projets ne nécessitant pas de permis de construire. Elle concerne notamment les extensions de moins de 20 m², les modifications de façade, l’installation d’un abri de jardin, ou encore la pose d’une clôture.
Ce document permet à la mairie de vérifier que votre projet respecte le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une fois déposée, la déclaration préalable fait l’objet d’un délai d’instruction de 1 mois. Sans réponse, l’autorisation est généralement considérée comme accordée tacitement.
Attention : réaliser des travaux sans cette formalité peut entraîner des sanctions et l’obligation de remettre les lieux en état.
👉 Avant tout projet, renseignez-vous auprès de votre notaire ou de la mairie pour savoir si une déclaration préalable est nécessaire.
La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) est un acteur clé du marché foncier rural en France. Elle intervient dans la vente de terrains agricoles, forestiers ou naturels afin de favoriser l’installation d’agriculteurs, la préservation de l’environnement et l’aménagement du territoire.
Dotée d’un droit de préemption, la SAFER peut se substituer à l’acquéreur d’un bien pour le réorienter vers un projet d’intérêt général. Toute vente de terrain en zone agricole ou naturelle doit donc lui être notifiée. En cas d’achat ou de vente dans ce cadre, il est essentiel de vérifier si la SAFER est concernée.
Ce mécanisme encadre les transactions rurales et peut impacter les délais et les conditions de vente.
👉 Consultez votre notaire pour anticiper l’intervention de la SAFER dans votre projet immobilier rural.
L’assurance-vie est un outil privilégié de transmission patrimoniale, en raison de sa fiscalité successorale avantageuse. Lors du décès de l’assuré, les capitaux versés aux bénéficiaires peuvent échapper aux droits de succession selon les articles 990 I et 757 B du Code général des impôts (CGI).
👉 Article 990 I : pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire dispose d’un abattement de 152 500 €. Au-delà, une taxation de 20 % s’applique jusqu’à 700 000 €, puis 31,25 %.
👉 Article 757 B : pour les primes versées après 70 ans, l’ensemble des bénéficiaires partage un abattement global de 30 500 €. Au-delà, les capitaux sont soumis aux droits de succession classiques, mais seuls les primes (et non les intérêts) sont taxables.
Cette distinction rend l’assurance-vie très efficace pour transmettre un capital à des proches en limitant la fiscalité, notamment pour des héritiers éloignés ou non parents.
Les frais de notaire correspondent aux sommes versées par l’acquéreur lors d’un achat immobilier, en plus du prix de vente. Contrairement à ce que leur nom indique, ils ne sont pas entièrement perçus par le notaire. Ils se composent de trois éléments :
1️⃣ Les droits de mutation (ou « frais d’enregistrement ») reversés à l’État et aux collectivités, représentant la plus grande part (environ 80 %) ;
2️⃣ Les débours, correspondant aux sommes avancées par le notaire pour obtenir divers documents (cadastre, hypothèques, géomètre, etc.) ;
3️⃣ Les émoluments du notaire, c’est-à-dire sa rémunération réglementée, calculée selon un tarif national fixé par décret.
Dans l’ancien, les frais de notaire s’élèvent à environ 7 à 8 % du prix de vente, contre 2 à 3 % dans le neuf. Ils sont indispensables pour garantir la sécurité juridique de la transaction et l’enregistrement de l’acte.
La réserve héréditaire est une part minimale du patrimoine que la loi garantit aux héritiers dits « réservataires », principalement les enfants. Elle vise à protéger ces derniers contre une exclusion totale de la succession. En présence d’un ou plusieurs enfants, une fraction du patrimoine leur est obligatoirement attribuée : la moitié pour un enfant, les deux tiers à partager entre deux enfants, et les trois quarts à répartir entre trois enfants ou plus. Le reste constitue la quotité disponible, librement transmissible à d’autres bénéficiaires (conjoint, ami, association…).
En l’absence d’enfants, le conjoint survivant peut être réservataire dans certaines situations. La réserve s’impose même en cas de testament ou de donation : si elle est atteinte, les enfants peuvent exercer une action en réduction pour récupérer leur part. Ce mécanisme est particulièrement important dans les familles recomposées ou en cas de libéralités excessives.
L’impôt sur la plus-value immobilière s’applique lors de la vente d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain) lorsque le prix de vente dépasse le prix d’achat. Il concerne les résidences secondaires, les biens locatifs ou les terrains à bâtir. Les résidences principales sont exonérées.
Cet impôt est dégressif, avec des abattements pour durée de détention. Il comprend deux volets : l’impôt sur le revenu (19 %) et les prélèvements sociaux (17,2 %), soit une imposition globale de 36,2 %. L’exonération partielle commence au bout de 5 ans de détention, puis augmente progressivement. L’exonération totale d’impôt intervient au bout de 22 ans, et celle des prélèvements sociaux au bout de 30 ans.
Le notaire calcule et prélève directement cet impôt lors de la vente. Des cas d’exonération spécifiques existent (première cession, vente de faible montant, expropriation…). Ce régime fiscal doit être anticipé pour optimiser la cession d’un bien immobilier.
Le quasi-usufruit est une forme particulière d’usufruit qui porte sur des biens dits « consomptibles par l’usage », c’est-à-dire des biens que l’on ne peut pas utiliser sans les consommer (argent, titres financiers, denrées, etc.). Contrairement à l’usufruit classique sur un bien non consomptible (comme un immeuble ou un meuble corporel), le quasi-usufruit autorise l’usufruitier à disposer librement des biens reçus : il peut en consommer, vendre ou utiliser la totalité, à condition d’en restituer l’équivalent en valeur au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit (souvent au décès de l’usufruitier).
Ce mécanisme est courant en droit des successions, notamment lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de sommes d’argent. Pour sécuriser les droits du nu-propriétaire, le notaire établit une convention de quasi-usufruit précisant les modalités d’utilisation et de restitution. Cette convention permet d’officialiser la créance de restitution et d’éviter les litiges futurs.
Le quasi-usufruit est un outil patrimonial efficace, à condition d’être bien encadré juridiquement. Il permet de concilier souplesse dans la gestion des liquidités et protection des héritiers.
Vous souhaitez en parler à votre notaire ? Prenez rendez-vous avec lui par courriel, par téléphone ou en ligne, en cliquant ici.
Contrairement à une idée reçue, le notaire peut exercer sur tout le territoire français : sa compétence est nationale. Il peut donc rédiger des actes, recevoir des signatures ou représenter des clients, peu importe la localisation du bien ou des parties.
Cette compétence nationale s’applique aussi bien aux ventes immobilières, qu’aux successions, donations, créations de sociétés, ou contrats de mariage.
À noter que certains actes nécessitent une présence physique (ex. : authentification de signature), mais beaucoup peuvent être traités à distance, grâce à la visioconférence sécurisée ou à la signature électronique à distance.
En résumé, que vous soyez en France ou à l’étranger, votre notaire à Orange peut vous accompagner efficacement et en toute sécurité.
La SCI (Société Civile Immobilière) est une structure juridique permettant à plusieurs personnes d’acquérir, détenir et gérer un ou plusieurs biens immobiliers en commun.
Chaque associé détient des parts sociales proportionnelles à son apport, ce qui facilite la gestion du patrimoine, la répartition des droits et la transmission progressive des biens. La SCI est souvent choisie pour :
-
Investir dans l’immobilier à plusieurs,
-
Transmettre un bien familial,
-
Organiser la gestion d’un patrimoine locatif.
Elle offre une grande souplesse de fonctionnement (prise de décision, bénéfices, mouvements d’associés), mais reste adaptée à une gestion à moyen ou long terme, et non à une revente rapide.
Outil de structuration patrimoniale, la SCI doit être pensée et rédigée avec soin. Pour cela, l’accompagnement d’un notaire est essentiel afin d’adapter les statuts de la SCI à votre projet et à votre situation personnelle.
Le choix entre l’Impôt sur les Sociétés (IS) et l’Impôt sur le Revenu (IR) a un impact direct sur la fiscalité des associés et la gestion des bénéfices.
Dans une société soumise à l’IS (comme la SAS ou la SARL), c’est la société qui paie l’impôt sur ses bénéfices. Les associés ne sont imposés qu’en cas de distribution de dividendes. Ce régime permet de réduire l’imposition personnelle et de réinvestir plus facilement dans la société.
À l’inverse, dans une société à l’IR (comme une SCI, une SNC ou une entreprise individuelle), les bénéfices sont imposés directement entre les mains des associés, en fonction de leur part, même s’ils ne sont pas distribués. Ce régime est souvent adapté aux projets immobiliers ou familiaux, notamment pour bénéficier du régime des revenus fonciers ou micro-BIC.
Le choix entre IS et IR dépend de nombreux critères :
-
La nature de l’activité,
-
Les objectifs patrimoniaux,
-
La stratégie de distribution des revenus.
Il est essentiel de se faire accompagner par un notaire pour opter pour le régime le plus adapté à votre situation.
Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal destiné à faciliter la transmission d’une entreprise familiale, en réduisant considérablement les droits de donation ou de succession.
Il permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, à condition de respecter certains engagements :
-
Engagement collectif de conservation des titres pendant au moins 2 ans,
-
Engagement individuel de conservation pendant 4 ans supplémentaires,
-
Poursuite de l’activité de l’entreprise concernée.
Ce régime s’applique aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve du respect des critères d’éligibilité.
Le pacte Dutreil constitue un outil essentiel pour :
-
Limiter le coût fiscal de la transmission d’entreprise,
-
Préserver la continuité de l’activité,
-
Anticiper une succession sans fragiliser l’entreprise familiale.
Son efficacité repose sur une anticipation juridique et fiscale, en lien avec un notaire ou un professionnel du patrimoine. Une stratégie à ne pas négliger pour assurer la pérennité de l’entreprise et optimiser la transmission familiale.
Besoin d’en parler avec votre notaire ? Prenez rendez-vous en cliquant ici.
Le compromis de vente engage à la fois l’acheteur et le vendeur. Il s’agit d’un avant-contrat synallagmatique : les deux parties s’engagent réciproquement, sous réserve des éventuelles conditions suspensives. L’acquéreur verse généralement un dépôt de garantie, et si l’une des parties se rétracte hors délai ou sans motif légitime, l’autre peut demander l’exécution forcée de la vente.
La promesse unilatérale de vente, en revanche, n’engage que le vendeur. Celui-ci s’engage à vendre son bien à un prix déterminé, pendant un certain délai, à un bénéficiaire qui dispose seul de la faculté d’acheter. En cas de renonciation, il perd l’indemnité d’immobilisation (en général 10 %).
Le choix entre les deux dépend de la stratégie juridique ou des négociations. Le compromis est plus équilibré, la promesse plus souple pour l’acquéreur.
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il offre une alternative au mariage, plus souple et rapide à mettre en place, tout en apportant un cadre juridique à la relation.
Il permet notamment une imposition commune, des droits sociaux (mutuelle, congés pour événements familiaux), une protection en cas de séparation (partage des biens selon le régime choisi), ainsi qu’une certaine sécurité en cas de décès (droit au logement temporaire, exonération des droits de succession si un testament a été établi).
Le PACS ne donne toutefois aucun droit automatique à l’héritage : un testament est indispensable pour protéger son partenaire.
Il est donc un outil juridique utile pour les couples souhaitant officialiser leur union sans se marier, tout en encadrant leur vie patrimoniale et personnelle.
Un notaire est un officier public nommé par l’État, chargé d’authentifier les actes juridiques et d’en garantir la valeur légale. Son rôle est double : il conseille les particuliers, les entreprises et les collectivités, tout en sécurisant juridiquement les actes importants de la vie.
Il intervient dans de nombreux domaines, dont vous pouvez retrouver la liste en cliquant ici.
Grâce à son devoir de neutralité et à sa formation juridique approfondie, le notaire garantit des actes fiables, opposables à tous, et dotés d’une force probante et exécutoire. Il est un acteur clé de la confiance et de la sécurité juridique en France.
Oui, les frais d’acquisition (couramment appelés « frais de notaire ») sont identiques partout en France, car ils sont strictement encadrés par l’État. On parle de « frais de notaire », mais ils comprennent essentiellement :
-
des droits et taxes reversés à l’État,
-
des débours pour les frais engagés (documents, formalités, etc.),
-
et une rémunération réglementée du notaire, appelée émoluments.
Peu importe le notaire ou la région, le coût reste le même pour un même type d’acte. Cela garantit une transparence et une égalité de traitement pour tous les clients.
Oui, vous pouvez choisir librement votre notaire. En France, cette liberté est garantie par la loi. Chaque partie à un acte notarié (par exemple, un acte de vente immobilière) peut désigner son propre notaire, sans frais supplémentaires pour autant. En effet, les notaires se partagent les émoluments fixés par l’État, donc cela ne coûte pas plus cher d’en avoir deux au lieu d’un.
Choisir son notaire permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et impartial, avec un professionnel qui défend vos intérêts, vous conseille et sécurise juridiquement l’opération.
Entre la promesse de vente et la signature définitive, il faut compter un délai moyen de 3 mois.
Ce délai intègre plusieurs éléments obligatoires, notamment le délai de purge du droit de préemption urbain par la mairie, le délai d’obtention d’un éventuel prêt immobilier par l’acquéreur et la réception de tous les documents administratifs requis pour la signature.
Ce délai peut être raccourci en l’absence de droit de préemption ou si l’acquéreur dispose immédiatement de son financement (aucune condition suspensive de prêt). Inversement, il peut s’allonger si les parties souhaitent négocier d’autres conditions suspensives, ou en présence de droits de préemption complémentaires, ou encore en cas de retard dans la transmission des pièces administratives.
Ainsi, bien que trois mois constituent une moyenne, chaque transaction est unique et peut varier en fonction des spécificités du dossier et de la volonté des parties.
Dans certaines communes, le conseil municipal peut imposer un contrôle du raccordement à l’assainissement collectif avant la vente d’un bien immobilier.
Le vendeur doit contacter la mairie pour vérifier si cette obligation s’applique. Si exigé, un rapport devra être établi avant la transaction. Ce document, valable trois ans à compter de sa réalisation, atteste de la conformité ou des éventuelles anomalies du raccordement. En cas de non-conformité, des travaux peuvent être requis. Cette vérification préalable permet d’anticiper d’éventuelles démarches et d’assurer une transaction en toute transparence pour l’acquéreur et le vendeur.
Les frais de notaire, appelés plus justement frais d’acquisition, sont l’ensemble des sommes que l’acquéreur d’un bien immobilier doit verser au notaire lors de la signature de l’acte de vente.
Contrairement à une idée reçue, la plus grande partie de ces frais (environ 80%) ne revient pas au notaire, mais est constituée d’impôts et taxes (droits d’enregistrement ou de mutation) que le notaire collecte pour le compte de l’État et des collectivités locales.
Environ 10% des frais correspondent aux émoluments du notaire, qui constituent sa rémunération pour son travail d’authentification de l’acte et de conseil. Ces émoluments sont réglementés par l’État.
Les 10% restants couvrent les débours, qui sont les dépenses engagées par le notaire pour les besoins de la transaction (frais de consultation du cadastre, d’obtention de documents d’urbanisme, etc.).
N’hésitez pas à contacter votre notaire pour obtenir une estimation des frais d’acquisition (en fonction du prix d’acquisition).
En matière de vente immobilière, les diagnostics immobiliers sont des évaluations techniques obligatoires qui informent l’acquéreur sur l’état du bien. Ils portent sur des aspects tels que la performance énergétique (DPE), la présence de plomb ou d’amiante, l’état des installations de gaz et d’électricité, les risques naturels et technologiques (ERP) et la présence de termites.
Ces diagnostics permettent à l’acheteur de connaître les éventuels défauts du bien et d’anticiper d’éventuels travaux. Ils protègent également le vendeur contre les recours pour vices cachés, à condition que tous les diagnostics obligatoires soient fournis.
Le dossier de diagnostics techniques (DDT) regroupant ces expertises doit être annexé à la promesse de vente et à l’acte authentique.
Ne pas fournir les diagnostics obligatoires n’exonérera pas le vendeur de la garantie des vices cachés envers l’acquéreur.
L’attestation de propriété immobilière est un acte notarié qui constate le transfert d’un bien immobilier aux héritiers après un décès. Elle remplace l’acte de vente et permet d’officialiser le changement de propriétaire sans nécessiter de partage immédiat. Cet acte est obligatoire pour mettre à jour le fichier immobilier et inscrire les nouveaux propriétaires au service de la publicité foncière. Il permet également aux héritiers de vendre ou de gérer le bien.
La déclaration de succession est un document fiscal obligatoire qui recense l’ensemble du patrimoine du défunt et permet de calculer les droits de succession dus par les héritiers.
Elle doit être déposée auprès de l’administration fiscale dans un délai de 6 mois après le décès (12 mois en cas de décès à l’étranger). Ce document mentionne les biens, dettes, donations antérieures et éventuelles exonérations applicables.
Son établissement est souvent réalisé avec l’assistance d’un notaire afin d’assurer sa conformité et d’éviter tout risque de pénalité en cas d’erreur ou de retard.
Un acte de notoriété est un document établi par votre notaire, attestant de l’identité et de la qualité des héritiers d’une personne décédée.
Il est indispensable pour prouver leur droit à la succession, notamment lors du partage des biens ou pour effectuer la déclaration de succession. Cet acte facilite ainsi les démarches administratives en confirmant qui sont les héritiers légitimes.
Un testament est un acte par lequel une personne, appelée testateur, exprime ses dernières volontés concernant la répartition de son patrimoine après son décès. Il permet de désigner les héritiers ou de léguer des biens spécifiques, tout en respectant les règles légales, notamment la réserve héréditaire.
Il existe principalement deux types de testament :
- le testament olographe, entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur ;
- le testament authentique, établi par un notaire en présence de témoins.
Ce document offre ainsi une sécurité juridique, tout en permettant au testateur d’organiser sa succession de manière personnalisée. En l’absence de testament, la dévolution du patrimoine se fera selon les règles légales établies par le Code civil.
Consultez votre notaire qui vous apportera tous les conseils nécessaires à la rédaction d’un testament adapté à votre situation familiale et patrimoniale.
Les frais liés à une succession se répartissent essentiellement en deux catégories.
- Les droits de succession, calculés sur la valeur nette taxable du patrimoine et dont le taux varie selon le lien de parenté entre le défunt et les héritiers.
- Les frais de notaire, qui englobent à la fois les honoraires réglementés et les débours (frais administratifs, frais d’enregistrement, publication des actes, etc.).
D’autres frais peuvent également s’ajouter, tels que les frais d’inventaire ou les frais éventuels liés à la liquidation et à la vente de biens immobiliers. L’ensemble de ces coûts peut représenter une part significative du patrimoine transmis.
Pour obtenir une estimation précise et anticiper ces frais, il est vivement conseillé de consulter votre notaire qui pourra vous accompagner tout au long du processus.
Dans le cadre d’une succession, le notaire intervient dès l’ouverture de la succession, suite au décès, pour recueillir tous les documents nécessaires – acte de décès, testament, inventaire des biens et dettes.
Il procède ensuite à l’établissement de l’acte de notoriété, qui désigne les héritiers légaux.
Après cette étape, il rédige la déclaration de succession qu’il dépose auprès de l’administration fiscale dans le délai légal (6 mois) pour procéder au paiement des droits de succession.
Une fois les droits de succession réglés et les dettes apurées, le notaire organise le partage du patrimoine en respectant soit les règles de dévolution légale, soit les dispositions testamentaires du défunt, en rédigeant une attestation de propriété immobilière.
La superficie « Carrez » est une mesure réglementée qui concerne les lots en copropriété.
Elle correspond à la surface privative réelle du bien, calculée selon la méthode définie par la loi Carrez du 18 décembre 1996. Seules les surfaces ayant une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m sont prises en compte, et on exclut les murs, cloisons, escaliers, gaines, ainsi que les embrasures de portes et fenêtres. Cette mesure vise à garantir une information transparente pour l’acheteur, en lui indiquant la surface réellement utilisable.
En cas d’écart supérieur à 5 % entre la superficie annoncée et la mesure réelle, l’acheteur peut demander une révision du prix de vente.
Cette règle s’applique uniquement aux biens en copropriété et n’est pas utilisée pour les maisons individuelles.
Le droit de préemption urbain (abrégé DPU) est un droit accordé aux communes ou à certains établissements publics leur permettant d’acheter en priorité un bien immobilier, avant tout autre acheteur.
Son objectif est d’assurer la maîtrise du foncier pour réaliser des projets d’intérêt général : logements sociaux, équipements publics, aménagements urbains, etc. Lorsqu’un bien est situé en zone de préemption, le notaire procèdera à la déclaration auprès du service compétent. Celui-ci dispose ensuite d’un délai légal de deux mois, pouvant dans certains cas être rallongé, pour décider s’il exerce ou non son droit de préemption.
L’intervention du notaire est obligatoire pour acter le transfert de propriété au fichier immobilier, qui n’accepte que les actes authentiques, sauf rares exceptions (jugements, modifications du cadastre, …).
L’avant-contrat (compromis de vente, promesse unilatérale de vente, …) peut être sous signatures privées, c’est à dire ne pas être rédigé et lu par un notaire. Nous déconseillons aux particuliers de rédiger eux-mêmes ces conventions. Lorsque la rédaction du compromis de vente est assurée par une agence immobilière, vous pourrez solliciter notre avis sur le projet, avant sa signature. Notre Office propose, bien entendu, de rédiger ces avant-contrats.
Sans l’intervention d’un notaire, les partenaires doivent rédiger une convention de PACS (libre ou via un modèle), réunir les pièces justificatives, puis déposer le dossier à la mairie.
Il est aussi possible de se pacser chez un notaire, qui prendra note de votre situation et de vos souhaits. Il rédigera ensuite votre convention et pourra vous pacser directement dans son Etude.
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles au sujet du PACS sur le site du Gouvernement, Service-Public en cliquant ici.
Un contrat de mariage doit être signé devant un notaire avant le mariage, idéalement quelques semaines à quelques mois avant la cérémonie. Sans contrat, le régime légal par défaut est la communauté réduite aux acquêts.
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous avec un notaire pour vous exposer les mécanismes de régime légal et envisager au besoin un régime spécifique, adapté à votre situation.