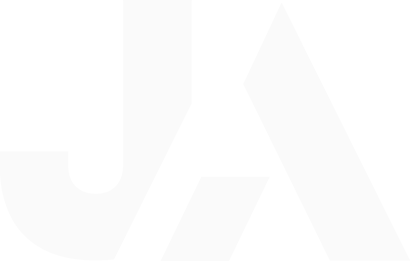Par Me Jérémy AUTHIER
partager

Vous prévoyez de réaliser des travaux sur la façade de votre maison, de changer vos fenêtres, ou d’installer une véranda ? Vous avez effectué des modifications extérieures sans autorisation et vous souhaitez régulariser votre situation ? La déclaration préalable de travaux (DP) est souvent la procédure adaptée.
Dans quels cas une déclaration préalable est-elle obligatoire ?
La déclaration préalable de travaux est une autorisation d’urbanisme exigée pour les travaux de faible importance modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, comme par exemple (liste non-exhaustive) :
-
Le remplacement ou la modification des menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets),
-
L’installation d’un velux ou la création d’ouvertures en façade,
-
Le ravalement de façade avec changement de couleur ou de matériaux,
-
La pose d’une véranda, d’une terrasse, ou d’un portail,
-
L’installation de panneaux solaires (photovoltaïques),
-
La fermeture d’un balcon ou d’une loggia,
-
La création d’une petite extension, d’un abri de jardin, etc.
Elle concerne aussi les constructions nouvelles de faible surface (par exemple, une extension ou une construction dont la surface de plancher est inférieure aux seuils fixés par la réglementation locale) et les changements de destination d’un local, sans modification de structure porteuse.
Cependant, les travaux de simple entretien ou réparation (comme un ravalement à l’identique ou un nettoyage ou le remplacement à l’identique de vos menuiseries en terme de couleur et matériau) ne nécessitent pas de déclaration, à moins qu’ils soient réalisés dans un secteur protégé ou soumis à des règles spécifiques définies par le PLU (Plan local d’urbanisme).
💡 Bon à savoir : certains travaux, même s’ils semblent anodins, nécessitent une déclaration dès lors qu’ils modifient l’aspect extérieur du bien, notamment dans une zone protégée ou soumise à des règles strictes du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Quelle procédure pour déposer une déclaration préalable en mairie ?
Le dossier de déclaration préalable doit être déposé à la mairie de la commune où se situe le bien. Il comprend :
- Un formulaire spécifique rempli et signé (formulaire cerfa n°16702-01)
- Un plan de situation du terrain,
- Des plans du projet (avant/après)
- Des photos ou vues d’insertion illustrant l’intégration dans l’environnement
⏳ Le délai d’instruction est généralement de 1 mois à compter du dépôt. En l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée, sauf disposition contraire plus stricte du PLU.
💡 Une fois le délai d’instruction purgé, pensez à récupérer auprès de la mairie l’attestation de non-opposition à déclaration préalable (si celle-ci ne vous a pas été délivrée automatiquement), utile lors de la revente de votre bien ou pour le notaire lors de la rédaction de l’acte de vente.
🔗 Lien utile : imprimé cerfa n°16702-01 (déclaration préalable : construction et travaux non soumis à permis de construire)
Affichage obligatoire et délai de recours des tiers
Une fois la décision obtenue ou le délai purgé, vous devez afficher la déclaration préalable sur votre terrain, conformément à l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme :
-
De manière visible depuis la voie publique,
-
Pendant 2 mois consécutifs,
-
Avec toutes les mentions obligatoires (nom, nature du projet, date de décision, etc.).
⚠️ Cet affichage constitue le point de départ du délai de recours des tiers, lequel permet à toute personne ayant un intérêt à agir (notamment les voisins) de contester l’autorisation d’urbanisme devant le juge administratif.
Ce délai de recours des tiers est de 2 mois à compter du premier jour d’un affichage régulier et continu. À défaut d’un affichage conforme ou en cas d’interruption dans l’affichage, ce délai ne court pas, ce qui peut entraîner un risque juridique important, notamment en cas de revente du bien ou de contrôle par l’administration. Il est donc vivement recommandé de conserver une preuve datée de l’affichage (photographies horodatées, constat d’huissier, etc.) afin de sécuriser votre situation.
💡 Astuce sécurité : conservez des photographies datées, voire un constat de commissaire de justice, pour prouver l’affichage continu et éviter toute contestation future.
Déclaration d’achèvement des travaux (DAACT)
Une fois les travaux terminés, vous devez adresser à la mairie une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) :
-
Elle permet à l’administration de vérifier la conformité avec l’autorisation obtenue,
-
Le délai de contrôle est de 3 mois, porté à 5 mois si le bien est situé dans un secteur protégé ou en site patrimonial remarquable.
Sans réponse dans ces délais, la conformité est réputée acquise. La DAACT est indispensable pour purger les délais de recours et sécuriser votre projet, notamment avant une vente immobilière.
Quand faut-il plutôt un permis de construire ?
Si les travaux de modification de l’aspect extérieur sont accompagnés d’un changement de destination du bâtiment, d’une extension ou d’une surélévation qui crée une nouvelle surface de plancher au-delà de certains seuils, d’une modification de la structure porteuse du bâtiment, alors un permis de construire est nécessaire.
En cas de doute, mieux vaut consulter un professionnel du droit immobilier ou le service urbanisme de la mairie.
Conseils pratiques
Avant tout dépôt de dossier ou démarrage de travaux, il est essentiel de :
1°/ Vérifier le PLU ou le document d’urbanisme applicable sur votre commune auprès de votre mairie, qui précise les règles et prescriptions locales (notamment dans les zones protégées ou à proximité de monuments historiques) ;
2°/ S’adresser au service d’urbanisme de votre commune pour connaître précisément si votre projet relève de la déclaration préalable ou s’il nécessite un permis de construire, surtout en cas de doute sur l’impact réel de l’aspect extérieur de votre bien immobilier.
3°/ Solliciter votre notaire, notamment si les travaux sont réalisés avant une vente : il pourra vérifier la conformité administrative et sécuriser votre transaction.
En résumé
La déclaration préalable de travaux est une procédure simplifiée, mais essentielle pour respecter les règles d’urbanisme et éviter des sanctions ou des blocages lors d’une revente. Elle garantit la légalité de vos travaux et la sécurité juridique de votre bien immobilier.
Par Me Jérémy AUTHIER
Partager
🏠 Le permis de louer : tout savoir avant de mettre un logement en location La mise en location d’un bien immobilier est aujourd’hui strictement encadrée par la loi. Parmi [...]
Transmettre son entreprise à ses enfants ou à ses héritiers est un moment clé dans la vie d’un chef d’entreprise. Au-delà des aspects humains et organisationnels, la fiscalité de la [...]
Le démembrement de propriété est une technique juridique et patrimoniale incontournable dans la pratique notariale.Souvent méconnu du grand public, il permet de transmettre un bien, réduire les droits de donation [...]
Qu’est-ce qu’une donation entre parents et enfants ? La donation est définie à l’article 894 du Code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le [...]