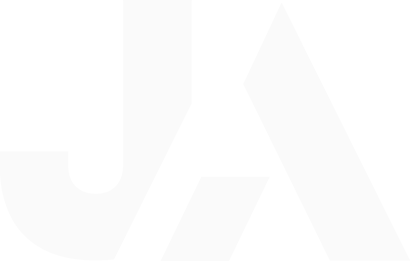Par Me Jérémy AUTHIER
partager

Le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif juridique et immobilier novateur, mis en place par l’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016, dont l’objectif est double : favoriser l’accession sociale à la propriété et lutter durablement contre la spéculation foncière. Reposant sur la dissociation du foncier et du bâti, le BRS permet à un acquéreur de devenir plein propriétaire de son logement, tout en louant le terrain à un organisme de foncier solidaire (OFS), via un bail à très longue durée, généralement compris entre 18 et 99 ans.
Ce montage original, inspiré des community land trusts anglo-saxons, permet de réduire le coût d’achat d’environ 15 à 40 % selon les zones. Le tout est encadré juridiquement de manière rigoureuse par le Code de la construction et de l’habitation (articles L.255-1 et suivants) afin de garantir une sécurité juridique à l’acquéreur comme à l’organisme foncier.
🎯 Objectifs du BRS : un logement durablement abordable
Instauré en France en 2017, le BRS a été conçu comme une solution durable pour contrer la flambée des prix du logement et la raréfaction des logements abordables. Son objectif principal est de garantir sur le long terme des logements accessibles aux foyers qui en ont le plus besoin, en stabilisant les prix d’achat et en empêchant la spéculation foncière. En encadrant strictement les conditions d’achat, d’occupation et de revente, le BRS pérennise un parc de logements à prix sociaux dans les zones tendues.
Le dispositif concerne essentiellement des logements destinés à l’habitation principale.
Le BRS vise à :
-
faciliter l’accession sociale à la propriété,
-
garantir des logements abordables à long terme,
-
éviter la spéculation immobilière,
-
favoriser la mixité sociale dans les zones tendues.
Ce mécanisme permet de réduire le prix d’achat d’un bien immobilier de 15 à 40 %, car l’acquéreur n’achète pas le terrain, seulement le bâti. Le terrain reste la propriété d’un OFS (association, collectivité, bailleur social…).
Pendant toute la durée du bail, le bien doit être occupé par le preneur ou sa famille à titre de résidence principale. Il s’agit le plus souvent de logements neufs (ou en état futur d’achèvement) produits en partenariat avec des promoteurs ou de logements anciens réhabilités par l’OFS. Par exemple, un OFS peut acquérir un terrain, y faire construire un immeuble d’habitation, puis consentir des BRS pour chaque appartement au profit de ménages éligibles. Les maisons individuelles peuvent également être concernées, dès lors qu’un OFS détient le terrain. Dans tous les cas, l’affectation du bien est strictement encadrée : usage exclusif d’habitation personnelle, pas de location touristique ou de résidence secondaire, ce qui assure que le logement profite à une famille modeste pendant toute la durée du bail.
Rôle de l’organisme de foncier solidaire (OFS) et du notaire
L’organisme de foncier solidaire (OFS) est un acteur central du BRS. Il s’agit d’une personne morale à but non lucratif agréée par l’État (association, fondation, organisme HLM, collectivité locale, etc.) dont la mission est d’acquérir et de gérer des terrains en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété. L’OFS reste propriétaire du foncier et consent des baux réels solidaires aux acquéreurs. Concrètement, c’est l’OFS qui sélectionne les ménages bénéficiaires (en vérifiant qu’ils respectent les conditions de ressources), définit les conditions du bail (durée, montant de la redevance, clauses d’occupation et de revente) et perçoit la redevance mensuelle versée par le preneur pour l’occupation du terrain. L’OFS s’assure également du respect sur le long terme de la vocation sociale du logement : contrôle de l’occupation en résidence principale, vérification des plafonds de revenus des occupants ou locataires éventuels et encadrement du prix en cas de revente. L’OFS dispose d’un droit de préemption sur le bien en cas de vente, afin de racheter ou de désigner un nouvel acquéreur dans les conditions du BRS (nous y reviendrons). Son rôle est donc à la fois celui d’un bailleur foncier social et d’un garant de la stabilité du dispositif sur la durée.
Le notaire, de son côté, joue un rôle indispensable dans la mise en place et la sécurisation juridique du BRS. Étant donné que le BRS confère des droits réels immobiliers sur une longue durée, sa conclusion doit obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié. Le notaire intervient pour rédiger et authentifier le bail réel solidaire ainsi que l’acte de vente du logement. Il vérifie la conformité du contrat aux exigences légales (durée entre 18 et 99 ans, clauses obligatoires, mention des conditions de ressources, etc.) et s’assure que toutes les parties (OFS et acquéreur) comprennent bien leurs engagements respectifs. Le notaire procédera également aux formalités de publicité foncière, en enregistrant le bail et la cession du bâti au fichier immobilier, ce qui garantit l’opposabilité du BRS aux tiers. En cas de revente du bien, le notaire accompagnera à nouveau les parties pour la signature de l’avenant ou du nouveau bail et de l’acte de revente, en veillant au respect du prix encadré et du droit de préemption de l’OFS. En somme, le notaire est le chef d’orchestre juridique qui sécurise chaque étape de l’opération et conseille l’acquéreur comme l’organisme foncier sur leurs droits et obligations.
Conditions d’éligibilité des acquéreurs
Le BRS est un dispositif d’accession sociale. L’accession n’est possible que si plusieurs critères stricts sont réunis :
-
Conditions de ressources : le dispositif s’adresse aux foyers modestes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil, variable selon la composition du ménage et la zone géographique. Ces plafonds, fixés par décret, sont alignés sur ceux du prêt social location-accession (PSLA) et évoluent chaque année. Par exemple, pour un couple sans enfant en zone A (région parisienne et grandes agglomérations), le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder 57 000 € environ. Plus le ménage est nombreux, plus le plafond est élevé. Ces ressources sont appréciées au moment de l’accès au dispositif (souvent, les revenus de l’année N-2 sont pris comme référence). L’objectif est de s’assurer que seuls les ménages qui n’auraient pas les moyens d’acheter dans le parc libre puissent bénéficier du BRS. Pour plus de détails concernant les plafonds de ressources, cliquez sur ce lien.
-
Statut de primo-accédant (souvent exigé en pratique) : le BRS vise prioritairement des primo-accédants, c’est-à-dire des personnes qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux dernières années (condition également exigée pour bénéficier d’un prêt à taux zéro). Ce critère n’est pas toujours absolu légalement, mais en pratique il est fréquent que les programmes en BRS ciblent des ménages primo-accédants pour maximiser l’effet social du dispositif.
- Ne pas être déjà propriétaire d’un autre logement générant des revenus importants : l’acquéreur ne doit pas déjà être propriétaire d’un logement susceptible de procurer à l’acquéreur des revenus suffisants pour lui permettre d’établir sa résidence principale dans un logement du parc privé, au moment où les conditions de la jouissance effective du logement objet du bail réel solidaire sont réunies.
-
Acheter un logement éligible : en général, il s’agit de logements neufs ou en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) proposés en BRS via un promoteur partenaire de l’OFS, ou plus rarement de logements anciens réhabilités. On ne peut pas appliquer un BRS sur n’importe quel bien existant sans l’intervention d’un OFS en amont. Il faut donc qu’un programme immobilier soit spécifiquement monté en BRS. Le particulier intéressé doit se manifester auprès de l’OFS ou du promoteur pour réserver un logement sous ce régime.
-
Occuper le logement en résidence principale : originairement, l’acquéreur s’engageait à occuper lui-même le bien au moins 8 mois par an (ou 6 mois selon les critères, l’idée étant qu’il y vive de façon habituelle). Le BRS interdisait alors l’investissement purement locatif par un particulier bailleur : on ne pouvait ni louer le bien (sauf éventuellement sous-location temporaire accordée par l’OFS dans des cas exceptionnels), ni le laisser vacant, ni en faire une résidence secondaire.
À noter qu’afin de répondre aussi procurations actuelles des propriétaires, un décret du 17 juillet 2024 est venu préciser que l’acquéreur pouvait désormais proposer à la location le logement acquis grâce à un BRS, sauf interdiction de mise en location mentionnée dans l’acte d’acquisition. Dans une telle situation, l’acquéreur devra au préalable signaler à l’OFS avec lequel le BRS a été signé si le projet de mise en location concerne l’ensemble du logement ou seule une partie de celui-ci et la période de cette mise en location. Les conditions de ressources devront également être respectées par le locataire du bâti.
Ces conditions d’occupation seront vérifiées à la signature et tout au long du bail.
-
Versement d’une redevance foncière : dès l’acquisition, le ménage signe non seulement l’acte de vente du bâti, mais aussi le bail pour le terrain. À ce titre, il doit payer chaque mois à l’OFS une redevance modeste correspondant à la mise à disposition du terrain et aux frais de gestion de l’organisme. En pratique, cette redevance est souvent de l’ordre de 1 à 3 € par m² de surface habitable par mois. Par exemple, pour un appartement de 60 m², on peut avoir une redevance autour de 60 à 180 € mensuels. La loi impose que ce montant reste compatible avec les capacités financières des ménages éligibles. Ce loyer du terrain est la contrepartie du prix d’achat réduit.
En résumé, l’accès à un BRS est conditionné à des critères proches de ceux du logement social, combinés à l’exigence d’une occupation effective. Les candidats doivent déposer un dossier auprès de l’OFS ou du promoteur, qui vérifiera leur éligibilité (justificatifs de revenus, composition familiale, etc.) avant de valider la vente. Une fois les conditions réunies, le processus d’achat peut être engagé, avec l’accompagnement du notaire pour la signature du bail et de l’acte de vente.
Droits et obligations de l’acquéreur sous BRS
Le statut d’acquéreur en BRS confère à la fois des droits proches de ceux d’un propriétaire classique sur le logement, et des obligations particulières liées au cadre spécifique du bail à long terme.
✅ Droits de l’acquéreur (preneur BRS) :
-
L’acquéreur dispose d’un droit réel immobilier sur son logement, ce qui lui assure la jouissance pleine et entière du bien. Il peut occuper le logement comme bon lui semble, y effectuer des travaux d’aménagement ou de rénovation intérieure, comme dans le cadre d’un achat immobilier classique. Il bénéficie d’une sécurité d’occupation sur une longue durée (le bail peut aller jusqu’à 99 ans), ce qui se rapproche d’une propriété viagère : il peut y habiter sa vie durant et même transmettre son droit à ses héritiers (sous conditions, nous allons y revenir plus loin).
-
L’acquéreur peut également financer son achat par un crédit immobilier comme tout propriétaire. Les banques sont généralement favorables au BRS, car le montage est sécurisé par l’État et l’OFS, et le bien peut servir de garantie hypothécaire. De plus, le preneur a droit aux aides réservées aux primo-accédants, notamment le prêt à taux zéro (PTZ), car l’achat en BRS est généralement assimilé à une accession à la première propriété. Cela améliore sa capacité d’emprunt et sécurise son plan de financement.
-
L’acquéreur BRS a le droit de revendre son logement ou de le transmettre, sous réserve de respecter les règles du dispositif. Il n’est pas « coincé » à vie : s’il souhaite déménager, il peut mettre en vente son droit réel, encadré par l’OFS (nous détaillons ci-après les modalités de revente). En cas de décès, ses héritiers peuvent hériter du bien, là encore dans le respect des conditions du BRS.
-
Enfin, le preneur bénéficie d’un cadre protecteur : le bail étant notarié et régi par la loi, l’OFS ne peut pas modifier arbitrairement les conditions en cours de route ni reprendre le bien avant l’échéance prévue (sauf manquement grave du preneur). En fin de bail (à l’issue des 18 à 99 ans), si le contrat n’est pas renouvelé, l’acquéreur (ou ses ayants droit) a droit à une indemnisation pour la valeur résiduelle du bâti qui retourne à l’OFS. Ce mécanisme évite une dépossession sans contrepartie. Notons qu’en pratique, le bail est souvent qualifié de « rechargeable » : lors de chaque revente, une nouvelle durée complète peut être consentie au nouvel acquéreur, de sorte que le bien conserve toujours sa valeur initiale et que personne ne se retrouve avec un bail trop écourté.
⚠️ Obligations de l’acquéreur :
En contrepartie de ces droits et du prix avantageux, l’acquéreur en BRS est tenu de respecter un certain nombre d’obligations spécifiques, destinées à maintenir le caractère social du logement :
-
Occupation continue en résidence principale : comme évoqué, le logement doit être la résidence principale du preneur tout au long du bail. Il ne peut ni l’abandonner ni l’utiliser comme résidence secondaire. La sous-location est en principe interdite (sauf accord exceptionnel de l’OFS, par exemple en cas d’absence temporaire justifiée). En cas de manquement à cette obligation d’occupation, l’OFS pourrait faire jouer une clause de résiliation du bail.
-
Paiement de la redevance foncière : le preneur doit s’acquitter régulièrement de la redevance convenue envers l’OFS, exactement comme un locataire paierait un loyer pour le terrain. Ce montant, indexé selon les termes du contrat, contribue aux frais de gestion de l’OFS et peut être révisé selon l’indice prévu à l’acte notarié. Le non-paiement de la redevance constituerait un manquement grave pouvant entraîner la résiliation du bail si le preneur ne régularise pas sa situation.
-
Entretien et réparations : l’acquéreur a une obligation d’entretien du logement. Il doit maintenir le bien en bon état, réaliser les petites réparations et travaux courants, et ne pas laisser le logement se dégrader. Certains travaux lourds affectant le bâti ou le terrain peuvent être encadrés : par exemple, il ne peut pas démolir une partie du bien ou réaliser des modifications structurelles qui diminueraient la valeur du bien sans l’accord de l’OFS. De même, l’OFS se réserve en général le droit d’intervenir pour les grosses réparations liées au foncier (par exemple des problèmes de structure du terrain), puisque cela relève du propriétaire du sol. Le partage des responsabilités peut être précisé dans le bail, souvent calqué sur le régime du bail emphytéotique (le preneur assume l’entretien courant et l’OFS les grosses réparations foncières).
-
Respect des clauses de revente : le preneur s’engage, s’il souhaite revendre le bien, à le faire dans le respect des conditions du BRS. Cela signifie qu’il doit informer l’OFS de son intention de vendre et obtenir son agrément préalable pour le nouvel acquéreur. Il ne peut pas vendre au plus offrant sur le marché libre ni à un prix libre : le prix de cession est plafonné selon une formule ou un barème défini pour garantir l’accessibilité au prochain ménage. Nous détaillons ci-dessous ces modalités, mais c’est une obligation essentielle du preneur : ne pas spéculer sur son logement BRS. En outre, si l’OFS décide d’exercer son droit de préemption et de racheter le bien au prix encadré, le preneur doit accepter cette priorité légale.
-
Autres obligations : comme tout propriétaire, le preneur doit respecter le règlement de copropriété le cas échéant (s’il achète un appartement en immeuble collectif), s’acquitter de ses charges et impôts (taxe d’habitation – désormais supprimée pour les résidences principales –, taxe foncière éventuellement réduite, voir plus bas) et assurer le logement. Le bail peut prévoir d’autres obligations spécifiques, par exemple l’interdiction de transformer le logement en local professionnel ou d’exercer une activité incompatible avec l’habitation.
En somme, les droits du preneur BRS sont très proches de ceux d’un propriétaire classique occupant, mais ses obligations sont renforcées pour conserver le caractère social et non spéculatif du dispositif. Cette contrepartie est généralement jugée équilibrée au vu des avantages obtenus en terme de prix d’achat.
Avantages du BRS pour l’acquéreur
Opter pour un bail réel solidaire comporte de nombreux avantages pour les particuliers qui souhaitent devenir propriétaires dans des zones où les prix sont habituellement prohibitifs. Voici les principaux bénéfices du dispositif :
-
Prix d’achat fortement réduit : c’est le premier atout du BRS. En dissociant le coût du terrain, le prix de vente du logement est nettement inférieur au marché libre, souvent 15 % à 40 % moins cher selon le secteur et la part du foncier dans le prix global. Par exemple, si un appartement vaut 200 000 € en pleine propriété, son prix en BRS pourrait n’être que de l’ordre de 120 000 à 170 000 € suivant la localisation, grâce à l’exclusion du foncier. Cette décote rend l’accession possible pour des ménages qui en seraient exclus autrement. De plus, le BRS stabilise le prix des logements dans le temps, évitant les envolées de valeur : on achète aujourd’hui à un prix abordable et on a l’assurance que la revente se fera dans les mêmes proportions encadrées, ce qui sécurise l’investissement sur le long terme.
-
Frais d’achat et fiscalité allégés : en plus du prix réduit, l’acquéreur BRS bénéficie de frais annexes plus faibles. Les frais de notaire sont réduits, car calculés uniquement sur le prix du bâti, et non sur le terrain. Pour un logement neuf, la TVA à l’achat est réduite à 5,5 % (au lieu de 20 %), ce qui représente une économie substantielle. Par ailleurs, les collectivités locales peuvent accorder un abattement de taxe foncière sur la part bâtie, généralement entre 30 % et 100 %, pendant toute la durée du bail. Dans de nombreuses communes, les propriétaires en BRS sont exonérés de taxe foncière ou n’en payent qu’une fraction, le terrain appartenant à l’OFS. Enfin, l’absence de foncier dans l’assiette taxable peut réduire certaines autres taxes. L’ensemble de ces avantages fiscaux améliore significativement le coût total de l’opération sur la durée.
-
Sécurité et accompagnement juridique : le BRS offre un cadre contractuel sécurisé par la loi et par l’intervention du notaire. L’acquéreur dispose d’un titre de propriété (droit réel) sur son logement, inscrit aux registres fonciers, ce qui protège sa position. De plus, le montage ayant été vérifié par un notaire, le contrat est clair sur les droits de chacun (par exemple, aucune crainte de voir le terrain vendu séparément à un tiers tant que le bail court). En cas de difficultés ou de questions, l’OFS reste un interlocuteur identifié qui peut accompagner l’acquéreur pendant la durée du bail (par exemple, pour une revente, pour valider des travaux importants, etc.). Cet accompagnement professionnel permanent et la vocation non lucrative de l’OFS créent un climat de confiance. Les ménages accédants en BRS soulignent souvent la tranquillité d’esprit qu’ils ont, par opposition à un achat classique où ils seraient seuls face aux aléas du marché.
-
Accès au crédit facilité : les banques voient généralement d’un bon œil ce dispositif soutenu par les pouvoirs publics. Le fait que le logement reste sous supervision d’un OFS et que l’acquéreur ait un engagement de long terme réduit le risque de défaut. En outre, la possibilité de cumuler avec un prêt à taux zéro améliore le plan de financement. Certains programmes BRS ont même des partenariats avec des établissements bancaires pour proposer des financements adaptés. Ainsi, l’accédant bénéficie d’une meilleure solvabilité aux yeux des prêteurs, malgré ses revenus modestes, ce qui augmente ses chances d’obtenir un emprunt à bon taux.
-
Mixité sociale et stabilité de l’occupation : bien que ce point soit plus général, il mérite d’être mentionné. En achetant en BRS, l’acquéreur contribue à un modèle solidaire qui favorise la mixité sociale dans des zones tendues. Des quartiers autrefois inaccessibles aux classes moyennes voient revenir des familles grâce au BRS, ce qui diversifie la population et peut redynamiser le tissu local. Pour l’acquéreur, c’est la possibilité de vivre dans un secteur qu’il n’aurait pu espérer habiter autrement (proximité du travail, des transports, etc.). De plus, sachant que tous les voisins en BRS sont dans la même logique d’occupation stable (pas de locations Airbnb ou de résidences secondaires vacantes), on constate souvent une stabilité du voisinage et un engagement des habitants à long terme dans la vie de la copropriété ou du quartier.
En synthèse, le BRS offre à l’acquéreur un levier financier puissant, sans pour autant le priver des attributs essentiels de la propriété. C’est un compromis gagnant entre location et propriété classique, souvent qualifié de « troisième voie » du logement, combinant les avantages des deux modèles.
Revente et transmission du bien sous BRS
Les modalités de revente ou de transmission d’un logement acquis en BRS sont très encadrées. Cela vise à garantir que le bien reste dans le circuit abordable pour les ménages modestes successifs et à empêcher une plus-value excessive individuelle. Voici comment cela se passe dans la pratique :
-
Durée du bail et renouvellement : un BRS est conclu pour une durée fixée dans le contrat, entre 18 et 99 ans. Si l’acquéreur souhaite vendre au cours de cette période, il vend les droits réels attachés au bail (c’est-à-dire son droit sur le logement jusqu’au terme prévu). Le nouveau preneur reprend le bail pour la durée restante. Toutefois, comme mentionné, il est d’usage de « recharger » la durée à chaque mutation : l’OFS peut consentir un nouveau bail de 99 ans au repreneur. Ainsi, pour le nouvel acquéreur, on repart sur une durée pleine, ce qui lui offre la même sécurité qu’au premier occupant et préserve la valeur du bien.
-
Procédure d’agrément et droit de préemption de l’OFS : avant toute revente, le preneur doit informer l’OFS de son intention de céder le bien. Cette notification permet à l’OFS de vérifier que le prochain acquéreur remplira les conditions d’éligibilité et d’organiser la transmission. L’OFS dispose d’un droit de préemption légal sur le bien : cela signifie qu’il est prioritaire pour racheter le logement aux conditions du BRS, s’il le souhaite, afin de le réattribuer ensuite. En pratique, deux cas peuvent se présenter :
-
Soit l’OFS décide de racheter lui-même le bien (directement ou via un bailleur social partenaire) au prix encadré convenu, puis le proposera à un nouveau ménage éligible.
-
Soit l’OFS renonce à préempter, et agrée un nouvel acquéreur proposé, qui doit bien sûr remplir les critères (revenus sous plafonds, etc.). Dans ce cas, la vente peut se faire directement de particulier à particulier, mais sous le contrôle de l’OFS qui valide le dossier du repreneur.
Dans tous les cas, une demande d’agrément doit être formulée et obtenue avant de conclure la vente. Sans cet agrément, la revente serait nulle. Ce fonctionnement garantit que le logement reste dans le giron du dispositif social BRS et n’en sort pas à l’occasion d’une mutation.
-
-
Encadrement du prix de revente : l’un des points clés est que le prix de revente du logement est plafonné. Le bail ou la réglementation fixent une formule de calcul de la valeur maximale à laquelle le preneur peut céder son bien. Souvent, cette formule est indexée sur l’évolution d’un indice (par exemple, l’indice de référence des loyers IRL ou un indice de prix immobilier local) pour suivre modestement l’inflation. Par exemple, un logement acheté 150 000 € en BRS pourra peut-être être revendu, dix ans plus tard, autour de 155 000 ou 160 000 € (plutôt que 250 000 € s’il avait suivi le marché libre), afin de rester abordable pour le prochain acquéreur. C’est l’OFS qui détermine le prix de cession autorisé lors de l’agrément, en application des critères convenus. Cette règle empêche le premier propriétaire de réaliser une plus-value spéculative importante, mais en contrepartie il a bénéficié à l’achat d’un prix réduit et d’une occupation sécurisée. D’une certaine manière, la plus-value latente reste « collectivisée » au profit des futurs accédants. Il s’agit d’un choix de solidarité intergénérationnelle propre au BRS.
-
Choix du nouvel acquéreur : comme indiqué, le nouvel acquéreur doit remplir les conditions d’éligibilité du BRS (plafonds de ressources, occupation en résidence principale, etc.), exactement comme le vendeur à son entrée dans le dispositif. Le logement ne peut donc pas être revendu à quelqu’un qui n’aurait pas pu l’acheter initialement en BRS. L’OFS est très attentive à ce point, et c’est souvent lui qui se charge de trouver ou de valider le candidat repreneur. Par exemple, l’OFS peut puiser dans sa liste d’attente de ménages candidats à l’accession sociale pour proposer un acheteur au vendeur. Cela simplifie parfois la vente pour le propriétaire sortant, qui a un intermédiaire pour trouver preneur.
-
Transmission familiale : qu’advient-il si l’acquéreur décède ou souhaite transmettre le bien à un proche ? Le BRS prévoit que le bail et le logement peuvent être transmis par succession ou donation, mais là aussi sous conditions. Si, par exemple, les enfants héritent du logement et souhaitent le conserver, ils doivent eux-mêmes entrer dans les critères de ressources du BRS. Si ce n’est pas le cas, l’OFS pourra exiger qu’ils revendent le bien à une personne éligible, ou exercer son droit de rachat. Toutefois, le conjoint survivant n’est pas soumis aux conditions de ressources : il peut continuer à occuper le logement en BRS même si ses revenus dépassent le plafond, ce qui évite de cumuler le drame familial avec une perte de logement. Cette clause protectrice vise à ne pas pénaliser un conjoint âgé qui hériterait du logement alors que ses revenus (épargne, retraite) excèdent les critères du dispositif. En résumé, la transmission est possible mais encadrée, toujours pour maintenir la vocation sociale du bien sur le long terme.
En définitive, la revente ou la transmission d’un bien en BRS est certes plus contraignante qu’une vente classique (on ne peut pas vendre au prix du marché libre ni à n’importe qui), mais ces contraintes sont la contrepartie logique de l’avantage dont on a bénéficié à l’achat. Le dispositif prévoit des mécanismes équilibrés pour que le propriétaire sortant récupère son capital (indexé) et qu’un nouveau ménage modeste prenne le relais dans les meilleures conditions.
Intérêts du BRS pour les investisseurs
Le bail réel solidaire est principalement pensé pour les accédants occupants, mais il présente également des atouts pour certains investisseurs immobiliers ou opérateurs qui souhaitent s’impliquer dans le développement de logements abordables, depuis le décret du 17 juillet 2024. À première vue, on pourrait penser que le BRS n’attire pas les investisseurs car il limite la plus-value à la revente. En effet, un investisseur classique cherchant une forte appréciation du capital pourrait être découragé par le plafonnement des gains. Cependant, plusieurs éléments peuvent rendre le BRS intéressant pour d’autres profils d’investisseurs, notamment ceux en quête d’investissement socialement responsable ou de revenus locatifs stables :
-
Opportunité d’investissement en zone tendue à moindre coût : grâce au BRS, le ticket d’entrée pour acquérir un logement dans des secteurs chers est plus faible. Un investisseur qui n’aurait pas les moyens d’acquérir un bien classique à Paris, par exemple, peut via le BRS acquérir le bâti d’un logement parisien sans le foncier, donc à un prix 30% plus bas (avec TVA 5,5% en prime). Certes, il devra respecter l’objectif social (louer le logement à un ménage éligible, à loyer modéré), mais il devient propriétaire d’un bien dans un emplacement premium avec un investissement initial réduit. De plus, le BRS sort le bien de la logique spéculative, mais assure la conservation de la valeur réelle du bien dans le temps (via le bail rechargeable). L’investisseur sait que même s’il ne peut réaliser qu’une plus-value limitée, son capital ne risque pas de décote brutale liée à un éventuel krach, car les prix sont lissés et garantis par l’encadrement. C’est une approche patrimoniale de long terme, privilégiant la stabilité sur le « coup » spéculatif.
-
Revenus locatifs sécurisés et fiscalité avantageuse : un investisseur qui achète un logement en BRS pour le louer (cas des BRS où le preneur n’occupe pas personnellement, mais s’engage à louer à un ménage sous plafond de ressources) peut y trouver son compte. D’une part, la demande locative pour des loyers abordables en zone tendue est très forte, donc le risque de vacance est faible. D’autre part, le loyer est encadré (souvent équivalent à un logement social type PLUS), donc modéré, mais plusieurs incitations fiscales viennent compenser cela. Comme pour tout logement neuf loué, l’investisseur peut opter pour le régime du loueur en meublé non professionnel (LMNP) au réel, ou investir via une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ces deux régimes permettent d’amortir le coût du logement sur plusieurs années et de déduire cet amortissement des loyers perçus, ce qui aboutit souvent à des loyers nets d’impôt sur une longue période. En clair, les revenus locatifs tirés d’un logement en BRS peuvent être défiscalisés en grande partie grâce à l’amortissement du bien, puisque le bien est acheté sans le foncier (on amortit le bâti sur, par exemple, 50 ans). Ainsi, un investisseur peut obtenir un rendement locatif sécurisé et optimisé fiscalement, sans ponction fiscale annuelle, tout en ayant rendu un service d’utilité sociale (loger un ménage modeste). Cette combinaison d’un risque locatif faible, d’une fiscalité douce et d’un investissement réduit peut séduire des investisseurs patrimoniaux à la recherche de revenus réguliers plutôt que de plus-values.
-
Partenariats avec des opérateurs publics ou parapublics : le BRS ouvre aussi des perspectives aux promoteurs et bailleurs sociaux. Un promoteur privé peut y trouver un modèle pour répondre à des appels d’offres de collectivités souhaitant du logement abordable, en obtenant des avantages (cession de terrain à prix réduit par la ville à l’OFS, TVA à 5,5%, etc.) et l’assurance de vendre rapidement les lots à un public solvabilisé par les aides. De leur côté, les organismes HLM peuvent utiliser le BRS pour diversifier leurs outils : par exemple, ils peuvent vendre en BRS une partie de leur parc locatif social à des locataires souhaitant accéder à la propriété, tout en maintenant ces logements dans le périmètre social sur le long terme. Cela leur permet de réinvestir dans de nouvelles constructions, tout en pérennisant la vocation sociale des logements cédés. Pour les collectivités et investisseurs institutionnels à visée sociale (fondations, investisseurs éthiques), soutenir un OFS ou participer à des programmes en BRS peut aussi présenter l’intérêt d’un impact social mesurable (logements durablement abordables) avec une rentabilité modérée mais stable.
En conclusion, si le BRS n’est pas conçu pour les investisseurs recherchant un profit rapide, il offre en revanche, notamment depuis le décret du 17 juillet 2024, un cadre attrayant pour ceux qui privilégient la pérennité et la sécurité : investissement initial réduit, actifs immobiliers dans des zones demandées, revenus locatifs stables et défiscalisés, et contribution à une mission d’intérêt général. Du point de vue d’un investisseur, c’est un placement « socialement responsable » qui peut s’inscrire dans une stratégie patrimoniale long terme, tout en bénéficiant de l’expertise des notaires et de la fiabilité juridique d’un montage encadré par l’État.
Conclusion
Le bail réel solidaire s’impose progressivement comme une troisième voie entre la location et la propriété traditionnelle, conciliant les avantages de l’accession (stabilité, constitution d’un patrimoine, liberté d’occupation) et la protection du logement abordable sur la durée. Pour un particulier désirant acheter son logement à moindre coût ou pour un investisseur intéressé par un projet socialement utile, le BRS offre un cadre sécurisé, innovant et pérenne. Bien entendu, la mise en place de ce dispositif requiert un accompagnement professionnel éclairé : le notaire, en partenariat avec l’OFS, est là pour expliquer les tenants et aboutissants, rédiger les contrats adaptés et garantir que l’opération se déroule dans le strict respect du cadre légal.
En définitive, que ce soit pour devenir propriétaire de sa résidence principale à prix maîtrisé ou pour investir autrement dans l’immobilier, le bail réel solidaire mérite l’attention. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire pour étudier la faisabilité d’une telle opération : chaque projet BRS est unique et doit être monté avec rigueur, mais il peut représenter une opportunité exceptionnelle d’accéder à la propriété tout en faisant partie d’un mouvement solidaire d’envergure nationale.
Maître Jérémy AUTHIER est à votre disposition pour vous guider pas à pas dans cette nouvelle aventure immobilière responsable.
Par Me Jérémy AUTHIER
Partager
🏠 Le permis de louer : tout savoir avant de mettre un logement en location La mise en location d’un bien immobilier est aujourd’hui strictement encadrée par la loi. Parmi [...]
Transmettre son entreprise à ses enfants ou à ses héritiers est un moment clé dans la vie d’un chef d’entreprise. Au-delà des aspects humains et organisationnels, la fiscalité de la [...]
Le démembrement de propriété est une technique juridique et patrimoniale incontournable dans la pratique notariale.Souvent méconnu du grand public, il permet de transmettre un bien, réduire les droits de donation [...]
Qu’est-ce qu’une donation entre parents et enfants ? La donation est définie à l’article 894 du Code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le [...]