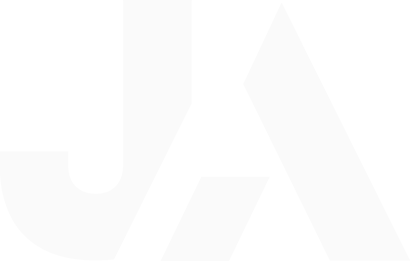Par Me Jérémy AUTHIER
partager

Le bail rural, aussi appelé bail à ferme, est le contrat par lequel un propriétaire de terres agricoles (le bailleur) loue son bien à un exploitant agricole (le preneur) qui va y exercer une activité agricole (culture, élevage, etc.). Ce type de bail est régi par le statut du fermage, un ensemble de règles d’ordre public destinées à protéger l’agriculteur locataire et à assurer la continuité de l’exploitation des terres. Dans ce guide pratique, je vous propose un tour d’horizon simple et pédagogique des points essentiels à connaître :
-
Qui peut conclure un bail rural ? (conditions pour être bailleur ou preneur)
-
La forme du bail (écrit obligatoire ou non, mentions nécessaires)
-
L’état des lieux (obligation, utilité, moment de réalisation)
-
La durée du bail (bail ordinaire de 9 ans, baux à long terme de 18 ans, 25 ans…, et baux spécifiques de courte durée : bail précaire, bail cessible, etc.)
-
La fixation du loyer (fermage) (modalités légales, barèmes préfectoraux, révision du loyer)
Chaque section développera ces aspects avec des explications claires, des exemples concrets, tout en restant juridiquement exact.
1. Qui peut conclure un bail rural (bailleur et preneur) ?
Le bail rural s’applique exclusivement à la location de biens immobiliers à usage agricole, c’est-à-dire des terres et éventuellement des bâtiments servant à l’exploitation agricole et/ou à l’habitation de l’exploitant. Il peut être conclu aussi bien entre personnes physiques (particuliers) qu’entre personnes morales (par exemple une société d’exploitation agricole). Il est même possible d’avoir plusieurs propriétaires bailleurs (co-bailleurs) ou plusieurs preneurs (co-preneurs) dans un même contrat.
Du côté du bailleur (propriétaire) : le bailleur est généralement le propriétaire du terrain. S’il s’agit d’une propriété en communauté entre époux, le conjoint du propriétaire doit consentir au bail pour que celui-ci soit valable. En cas d’indivision (plusieurs cohéritiers d’une terre, par exemple), tous les co-indivisaires doivent donner leur accord pour louer le bien. Enfin, si le droit de propriété est démembré, l’usufruitier peut conclure un bail rural à condition d’obtenir l’accord du nu-propriétaire ; en cas de refus de ce dernier, l’usufruitier peut demander l’autorisation au tribunal (exemple : si une parcelle agricole appartient à trois frères en indivision, aucun ne peut la louer sans l’accord des deux autres ; de même, si Madame X possède l’usufruit d’une terre dont son fils est nu-propriétaire, elle ne pourra la donner à bail qu’avec l’aval de son fils).
Du côté du preneur (locataire) : le preneur doit être un exploitant agricole (ou en passe de le devenir) qui va cultiver la terre louée. Il peut s’agir d’un agriculteur individuel, d’un GAEC, d’une EARL, etc. En pratique, toute personne qui prend à bail des terres agricoles est soumise au “contrôle des structures”, un dispositif qui vise à réguler l’accès au foncier agricole. Cela signifie que selon la taille de l’exploitation résultante, le preneur devra éventuellement obtenir une autorisation d’exploiter auprès de la préfecture (ou faire une simple déclaration) avant de s’installer. Le bailleur et le preneur doivent donc vérifier que le preneur remplit les conditions administratives pour exploiter les terres (surface totale de l’exploitation ne dépassant pas certains seuils, capacités professionnelles, etc.). Par ailleurs, si le preneur est un ressortissant non européen, il doit obtenir une autorisation spéciale (carte d’exploitant agricole) en plus de l’autorisation d’exploiter (exemple : un jeune maraîcher qui souhaite louer 30 hectares devra s’assurer que l’ajout de ces hectares ne le fait pas dépasser le seuil fixé dans sa région, sans quoi il devra demander une autorisation préalable d’exploiter).
👉 En résumé : le bail rural peut être conclu par toute personne ou société propriétaire de terres agricoles (avec l’accord éventuel des co-propriétaires, conjoint ou nu-propriétaire) et par tout agriculteur respectant les conditions légales d’exploitation (procédure administrative d’autorisation si nécessaire). Le contrat peut désigner plusieurs bailleurs et/ou plusieurs preneurs, selon les situations.
🔗 Source : entreprendre.service-public.fr
2. La forme du bail rural : écrit, mentions obligatoires et contenu
Le bail rural doit-il être écrit ? En principe, oui, la loi prévoit un écrit : l’article L411-4 du Code rural et de la pêche maritime indique que les contrats de bail rural doivent être rédigés par écrit.
🔗 Source : article L411-4 du Code rural et de la pêche maritime
Cependant, l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité : un bail rural verbal reste valable s’il remplit par ailleurs les conditions du bail rural (objet agricole, etc.). Autrement dit, un accord oral entre un propriétaire et un exploitant peut former un bail à ferme valide, mais il sera réputé durer 9 ans et les clauses du bail type départemental s’appliqueront par défaut.
⚠️ Il est fortement déconseillé de se contenter d’un bail verbal, car en cas de litige il est très difficile d’en prouver les termes, ce qui est source de conflits devant le Tribunal paritaire des baux ruraux. Un contrat écrit est donc vivement recommandé, ne serait-ce que pour disposer d’une preuve claire de l’accord (loyer convenu, durée, clauses particulières, etc.).
Mentions obligatoires et contenu important : le bail rural écrit peut être établi soit par acte sous seing privé (rédigé et signé par les parties, éventuellement en utilisant un modèle-type disponible), soit par acte notarié. Certaines mentions sont imposées par la loi : en particulier, le preneur doit déclarer dans le bail la superficie et la nature des biens qu’il exploite déjà (les terres qu’il a éventuellement ailleurs). Cette mention est obligatoire et conditionne la validité du contrat. L’objectif est d’informer sur l’importance de l’exploitation du preneur et de vérifier le respect du contrôle des structures. De manière générale, le bail doit comporter l’identité des parties (bailleur(s) et preneur(s)), la désignation précise des parcelles louées (avec leur surface, cadastre…), la destination agricole des biens (type de culture ou d’élevage envisagé), la durée du bail, le montant du fermage (loyer) et ses modalités de paiement, ainsi que les clauses particulières convenues. Chaque département dispose d’un contrat-type départemental élaboré par la Commission consultative des baux ruraux, qui peut servir de référence ou de modèle aux parties. En l’absence de mentions spécifiques, c’est ce contrat-type qui comble les vides du bail (surtout en cas de bail verbal).
Cas particulier des baux de longue durée (> 12 ans) : si les parties conviennent d’une durée de bail supérieure à 12 ans, alors l’acte doit obligatoirement être notarié et publié au service de la publicité foncière (bureau des hypothèques). Un bail de plus de 12 ans est en effet soumis à publicité foncière comme les autres droits immobiliers, et seule la forme authentique (acte notarié) permet cette publication. Dans ce cas, on parle de bail authentique ou bail notarié. Cela présente l’avantage de donner au bail une date certaine opposable aux tiers.
Par exemple, si le propriétaire vend son terrain pendant le bail, le preneur ne pourra pas être expulsé par l’acheteur : le bail publié, antérieur à la vente, continue de s’imposer au nouveau propriétaire. De même, si par malheur un bailleur peu scrupuleux avait loué la même terre à deux agriculteurs différents, celui dont le bail a la date certaine la plus ancienne serait protégé.
💡À noter : même en deçà de 12 ans, certains bailleurs et preneurs choisissent de passer le bail devant notaire pour sécuriser la transaction et bénéficier de conseils juridiques. C’est un coût supplémentaire, mais qui peut éviter bien des ennuis ultérieurs.
👉 En résumé : le bail rural peut légalement être verbal, mais il est fortement conseillé de le formaliser par écrit pour prévenir les litiges. Le contrat doit comporter toutes les informations essentielles (identité des parties, description des terres, durée, loyer, etc.), et doit mentionner la surface et la nature des terres exploitées par le preneur pour être valable. Pour les baux de plus de 12 ans, l’acte notarié et la publication au fichier immobilier sont obligatoires, ce qui confère une sécurité juridique accrue au preneur.
3. L’état des lieux : obligation, utilité et moment de sa réalisation
Lorsqu’un agriculteur prend possession d’une exploitation en location, il est très utile de réaliser un état des lieux d’entrée. S’agit-il d’une obligation légale ? En matière de bail rural, l’état des lieux n’est pas imposé par la loi (contrairement à la location d’un logement d’habitation, par exemple). Toutefois, il est vivement conseillé d’en dresser un, car c’est un document précieux pour la suite du bail.
À quoi sert l’état des lieux ? C’est un constat descriptif détaillé de l’état initial des terres et des bâtiments loués. On va y consigner : la qualité et l’entretien des sols (parcelles labourées ou enherbées, éventuels signes d’érosion, rendement moyen des cultures sur les cinq dernières années, etc.), l’état des clôtures, des fossés, des haies, l’état des bâtiments d’exploitation (toiture, structure, installations électriques, etc.) et éventuellement du logement (toiture, murs, etc.) s’il y en a un.
Par exemple, on notera si une prairie est envahie de ronces ou au contraire bien entretenue, si le sol a reçu des aménagements (drainage, irrigation), ou encore si la grange présente des fissures. Toutes ces informations serviront de référence lors de la restitution du bien en fin de bail. En effet, l’état des lieux permet de déterminer les indemnités dues le moment venu : si le preneur a réalisé des améliorations (par exemple plantation de haies, construction d’un hangar, bon entretien augmentant la productivité), il pourra réclamer une indemnité au bailleur en fin de bail ; à l’inverse, si le locataire a dégradé le fonds (par négligence entraînant une perte de fertilité, bâtiment dégradé…), le bailleur pourra lui demander réparation.
⚠️ Sans état des lieux, la loi présume que le preneur a reçu terres et bâtiments en bon état initial et il devra donc les rendre en bon état, quelle que soit la réalité au départ. Cette présomption joue en défaveur du locataire : s’il n’a pas fait constater que la toiture de la grange était déjà partiellement effondrée en arrivant, il pourrait être tenu de la remettre en état à ses frais en partant. D’où l’intérêt majeur de l’état des lieux amiable !
À quel moment et comment le réaliser ? L’état des lieux d’entrée se fait au plus proche de la prise de possession par le preneur. Idéalement, il est établi dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Bailleur et preneur le réalisent ensemble, en se rendant sur place pour examiner chaque parcelle et chaque installation. Ils peuvent se faire aider d’un spécialiste (conseiller de la chambre d’agriculture, expert agricole) s’ils le souhaitent, surtout si l’exploitation est grande ou complexe. Les frais éventuels pour établir l’état des lieux (par exemple si on mandate un expert) sont en principe partagés par moitié entre bailleur et preneur. Le document doit être fait en deux exemplaires et signé par les deux parties. Il pourra être annexé au bail ou conservé précieusement par chacun.
💡 Astuce : les Chambres d’agriculture proposent parfois des grilles ou guides d’état des lieux très détaillés pour n’oublier aucun point, distinguant chaque parcelle et chaque bâtiment. Il peut être judicieux d’en utiliser un pour n’oublier ni la consistance des terres (prairie, vigne, culture annuelle…), ni les structures (clôtures, drains, bâtiments), ni l’historique des rendements agricoles récents sur le fonds.
🔗 Exemple de grille d’état des lieux mis en place par le département de la Drôme
👉 En résumé : rien n’oblige formellement à faire un état des lieux, mais il est fortement recommandé d’en établir un conjointement, au tout début du bail. Ce constat écrit protège les deux parties en fixant une référence sur l’état du fonds : sans lui, le preneur est réputé avoir reçu un bien en bon état et devra le restituer tel quel. Avec un état des lieux, on pourra objectivement comparer l’état initial et final et calculer d’éventuelles indemnités pour amélioration ou dégradation. Prenez donc le temps de le faire, c’est un petit investissement pour éviter de gros désaccords plus tard !
4. La durée du bail rural : 9 ans, long terme, et cas de courte durée
Durée minimale de 9 ans (bail rural ordinaire) : en France, la durée légale minimale d’un bail rural est de 9 ans.
🔗 Source : article L411-5 du Code rural et de la pêche maritime
Cela signifie que même si les parties prévoyaient une durée plus courte dans le contrat, ou même en l’absence d’écrit, le bail sera réputé conclu pour 9 ans au minimum en application du statut du fermage. Le bail à ferme “ordinaire” de 9 ans est le cas le plus fréquent et il bénéficie pleinement des protections du statut du fermage (droit au renouvellement, droit de préemption du preneur en cas de vente, etc.). Les parties ne peuvent pas y déroger : par exemple, on ne peut pas priver le preneur de son droit au renouvellement dans un bail 9 ans, ni convenir d’une durée initiale plus courte en pensant échapper à ces règles. Dans les faits, un bail conclu pour 5 ans sera automatiquement requalifié en bail 9 ans (sauf exception légale particulière, voir plus loin).
Au terme des 9 ans, si personne ne donne congé, le bail est reconduit tacitement pour une nouvelle période de 9 ans, et ainsi de suite. Le congé (délai et motif) est strictement encadré par la loi et doit être donné 18 mois avant l’échéance, sinon le bail se renouvelle automatiquement. En général, le preneur a vocation à rester sur l’exploitation longtemps : il bénéficie d’un droit au renouvellement indéfini de 9 ans en 9 ans, sauf motif légitime de reprise par le bailleur. Le bailleur ne peut reprendre ses terres qu’à certaines conditions précises prévues par la loi (par exemple pour exploiter lui-même le bien en fin de bail, ou en cas de faute grave du preneur, etc.). De son côté, le preneur peut aussi résilier anticipativement dans quelques cas (retraite, invalidité, achat d’une autre ferme pour y exploiter à la place…). Ces cas de résiliation anticipée restent relativement encadrés afin de garantir la stabilité de l’exploitation.
Les baux ruraux à long terme (18 ans, 25 ans, carrière) : la loi a prévu des baux de plus longue durée, qualifiés de baux à long terme, d’une durée d’au moins 18 ans. Ces contrats offrent une sécurité encore plus grande au preneur, qui est assuré de pouvoir exploiter pendant une période plus longue sans renégociation. On distingue principalement :
-
Le bail de 18 ans (bail à long terme “classique”) – Durée minimale de 18 ans. C’est le format le plus courant des baux à long terme. À l’issue de la période initiale, le bail se renouvelle par périodes de 9 ans automatiquement, aux mêmes clauses, sauf congé donné. Bien sûr, comme tout bail, il peut aussi prendre fin avant terme en cas de résiliation amiable ou judiciaire, ou si le bailleur exerce son droit de reprise dans les cas autorisés (familial, construction d’une maison d’habitation, etc.). Exemple : un jeune agriculteur signe en 2025 un bail de 18 ans sur des vignes. Sauf incident, il est tranquille jusqu’en 2043. Ensuite, si le bailleur ne reprend pas le bien, le bail se prolongera par tranches de 9 ans, ce qui peut l’emmener jusqu’à 2052, et ainsi de suite.
-
Le bail de 25 ans – Durée minimale de 25 ans. Ce bail très long offre encore plus de stabilité. Il n’y a pas de renouvellement automatique sauf si une clause de tacite reconduction est insérée dans le contrat. Avec une telle clause, le bail de 25 ans se prolonge indéfiniment tant que personne ne donne congé, mais le bailleur ne peut résilier qu’à des échéances particulières (il doit attendre la fin de la 4e année suivant l’échéance initiale avant de pouvoir faire effet à un congé). En l’absence de clause de reconduction, le bail prend simplement fin à 25 ans sans formalité. Exemple : bail signé en 2020 pour 25 ans avec tacite reconduction. Le bailleur souhaite récupérer son bien à l’échéance initiale de 2045 : il devra tout de même donner congé avant la fin de la 21e année (soit avant 2041) pour que ce congé prenne effet en 2045.
-
Le bail de carrière – Il permet au preneur d’exploiter les terres pendant toute sa carrière professionnelle. Sa durée minimale est de 25 ans, mais en pratique, il dure jusqu’à ce que le preneur atteigne l’âge de la retraite agricole. Plus précisément, il prend fin à la fin de l’année culturale au cours de laquelle le preneur fait valoir ses droits à la retraite. Ainsi, le bail peut durer 30, 35 ans ou plus selon l’âge de départ en retraite. C’est le bail qui offre la plus grande stabilité pour l’exploitant, puisqu’il est certain de conserver la terre tout au long de sa vie active.
Le bail cessible hors cadre familial : il s’agit d’un bail rural particulier d’une durée d’au moins 18 ans, souvent classé parmi les baux à long terme en raison de sa durée minimale élevée. Sa particularité est d’autoriser la cession du bail beaucoup plus librement que d’habitude. En temps normal, un preneur ne peut céder son bail qu’à un membre de sa famille proche (descendant, conjoint, partenaire pacsé) et sous conditions. Avec le bail cessible hors cadre familial, le preneur peut transmettre son bail à un tiers, même sans lien de famille et sans l’accord du bailleur. Cela offre une souplesse appréciable : par exemple, un agriculteur en fin de carrière pourrait céder son bail (le vendre) à un jeune hors de sa famille, ce qui n’est pas autorisé dans un bail classique. En contrepartie, le bailleur dispose de certaines facultés pour s’opposer au renouvellement de ce bail ou y mettre fin de façon anticipée dans des cas précis (faute du preneur, reprise pour construire, refus de renouvellement moyennant une indemnité d’éviction, etc.). Le bail cessible reste toutefois rare et nécessite un acte notarié lui aussi.
Les baux ruraux de courte durée et situations dérogatoires : le principe des 9 ans minimaux souffre quelques exceptions légales où la durée initiale peut être plus courte dès la conclusion du contrat. Ces dérogations existent pour répondre à des besoins spécifiques sans remettre en cause le statut protecteur du fermage. Parmi elles :
-
Le bail de petite parcelle : concerne la location de toute petite surface agricole. Chaque département fixe par arrêté préfectoral une superficie maximale (variable selon la nature de la culture) en dessous de laquelle un bail est qualifié de “petite parcelle”. Par exemple, dans tel département viticole, une vigne de moins d’1 hectare peut être considérée comme petite parcelle. Si les conditions sont remplies (très faible surface, ne constituant pas une part essentielle de l’exploitation du preneur, etc.), le bail de petite parcelle échappe en partie aux règles du statut du fermage. Notamment, pas de durée minimale imposée : les parties peuvent convenir librement d’une durée plus courte qu’à l’accoutumée. Elles peuvent aussi écarter le droit au renouvellement, le droit de préemption, l’encadrement du loyer, etc. En revanche, d’autres dispositions protectrices demeurent (indemnités au preneur sortant, tribunal compétent…). Exemple : un propriétaire loue 0,5 ha de verger à son voisin pour 2 ans afin de “voir comment ça se passe”. Étant sous le seuil de la petite parcelle fixé localement, ils peuvent légalement signer pour 2 ans seulement, sans atteindre 9 ans. Attention, si le bail de petite parcelle est verbal, sa durée sera tout de même fixée au temps nécessaire pour réaliser une récolte (par exemple 1 an pour des vignes). De plus, si au renouvellement la surface dépasse le seuil préfectoral (qui peut évoluer), le bail basculera dans le statut normal.
-
La location annuelle renouvelable en attendant l’installation d’un descendant : ce dispositif permet à un propriétaire de louer un bail d’un an, renouvelable jusqu’à 6 ans maximum à un agriculteur déjà en place, en attendant que son descendant soit en âge et prêt à reprendre l’exploitation familiale. Chaque année, le bail est reconduit jusqu’à ce que le fils/fille (ou autre descendant désigné) s’installe, sans dépasser 6 ans. Ce bail dérogatoire n’est possible que si le preneur est déjà agriculteur (exploitant installé sur une autre ferme) et si la future installation concerne un descendant majeur du bailleur (nommément désigné dans le contrat). Là encore, pendant cette période transitoire, certaines règles du statut peuvent être écartées (pas de droit au renouvellement notamment). Si au bout de 6 ans le descendant ne s’est pas installé, le bail se transforme automatiquement en bail rural classique de 9 ans à partir de la fin de la 6e année.
-
Le bail conclu dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire : si un exploitant en difficulté fait l’objet d’une cession de son exploitation par le tribunal, les baux ruraux conclus à cette occasion peuvent déroger à la durée de 9 ans. L’objectif est de faciliter la reprise des terres par un nouveau fermier sans l’engager sur 9 ans obligatoirement. La loi prévoit essentiellement que seul le volet “indemnité de sortie” du statut du fermage reste impératif dans ce cas particulier.
-
Autres cas particuliers : certains baux passés par les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) peuvent aussi avoir une durée plus courte, lorsqu’une SAFER sous-loue temporairement des biens dans l’attente de les réattribuer de façon pérenne. De même, les baux consentis par l’État ou des collectivités sur leur domaine agricole public peuvent être exclus du droit au renouvellement automatique (le preneur est informé à l’avance que le bail ne sera pas reconduit).
La convention d’occupation précaire : on entend souvent parler de “bail précaire” en agriculture. En réalité, la loi ne prévoit pas à proprement parler de “bail rural précaire”, mais elle autorise une convention d’occupation précaire dans certaines conditions très spécifiques. Il s’agit d’un accord précaire et révocable qui permet d’échapper au statut du fermage – et donc à la rigidité du bail 9 ans – à condition que la précarité soit justifiée par les circonstances. Typiquement, on y recourt lorsque le propriétaire sait qu’il aura besoin du terrain sous peu pour un projet non agricole (construction d’un bâtiment, projet urbanistique, etc.), mais qu’en attendant, il laisse un agriculteur l’exploiter à titre précaire. La convention doit mentionner clairement l’événement incertain justifiant la précarité (par exemple : obtention d’un permis de construire, vente possible à tout moment…) et prévoir qu’elle prendra fin dès que cet événement se réalisera. Attention : si la précarité n’est pas réelle et que le propriétaire voulait juste éviter un bail rural classique, le juge pourra requalifier la convention en bail rural de 9 ans ! En outre, la convention d’occupation précaire ne confère pas au preneur la même protection (pas de droit au renouvellement ni à indemnité). Elle doit rester exceptionnelle (exemple : une commune prévoit d’affecter un terrain à un lotissement dans quelques années, mais tant que le projet n’est pas finalisé, elle permet à un éleveur voisin d’y faire pâturer son troupeau sous une convention précaire. Lorsque les travaux commenceront, l’éleveur partira sans pouvoir exiger de maintien ni de compensation, car il a accepté le caractère provisoire dès le départ.)
👉 En résumé : le bail rural “ordinaire” dure au minimum 9 ans, et se renouvelle tacitement pour 9 ans sauf congé régulier. Il existe des baux ruraux de plus longue durée (18 ans, 25 ans, bail de carrière) qui offrent une stabilité encore accrue aux exploitants, ainsi qu’un bail cessible qui permet au preneur de céder librement son bail à un tiers hors famille. À l’inverse, quelques exceptions permettent une durée initiale plus courte dans des situations particulières (très petite parcelle, bail d’attente pour installation d’un descendant, convention réellement précaire…). En dehors de ces cas, toute location de terres agricoles s’analyse en un bail soumis au statut du fermage, avec sa durée plancher de 9 ans et ses protections pour le preneur.
5. La fixation du loyer (fermage) : barèmes, indexation et révision du loyer
Le loyer d’un bail rural est appelé fermage. C’est la somme (ou la quantité de récolte) que verse le preneur en contrepartie de la mise à disposition des terres et bâtiments de l’exploitation. Contrairement à une location classique, le fermage n’est pas librement fixé par les parties : son montant est encadré par la loi et les arrêtés préfectoraux de chaque département.
Barèmes préfectoraux minima-maxima : dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe des limites minimum et maximum pour le prix des locations de terres agricoles. Ces barèmes sont généralement exprimés en euros par hectare et par an, en fonction de la qualité des terres (par exemple terres de culture, prairies, vignes classées en crus, etc.). Le loyer du bail doit être compris entre ce minimum et ce maximum légaux. À l’intérieur de cette fourchette, bailleur et preneur négocient à l’amiable le montant exact du fermage. On ne peut pas dépasser le plafond, ni descendre sous le plancher imposé. Ces limites sont actualisées chaque année d’après l’indice national des fermages, publié par le ministère de l’Agriculture avant le 1er octobre. L’indice des fermages reflète l’évolution du revenu agricole et du niveau général des prix.
Par exemple, en 2025, l’indice national des fermages est de 122,55, en hausse de 5,23 % par rapport à 2024. Cela signifie que les loyers agricoles peuvent être revalorisés de 5,23 % cette année-là. Illustration : si en 2024 un fermier payait 3 450 € pour 25 hectares, en 2025 le loyer réactualisé devient 3 450 € + (3 450 × 5,23 %) ≈ 3 630 €. Ce mécanisme d’indexation automatique permet d’ajuster le loyer chaque année sans avoir à renégocier formellement le bail.
Loyer en nature (métayage) : à noter que dans certains cas spécifiques (notamment pour les terres nues à vocation viticole, arboricole, oléicole ou agrumicole), la loi permet de fixer le fermage non pas en argent, mais en quantité de denrées. Par exemple, le fermage d’une vigne peut être payé en bouteilles de vin ou en pourcentage de la récolte (cas du bail à métayage). Là encore, des limites (mini-maxi) en quantité sont prévues par arrêté préfectoral. Le bail doit alors préciser la quantité de récolte due au propriétaire chaque année. Ce type de fermage en nature est aujourd’hui moins courant que le paiement en argent, sauf en métayage pur où le preneur et le bailleur se partagent les produits de l’exploitation (souvent 1/3 pour le bailleur, 2/3 pour le preneur). Dans la grande majorité des baux à ferme, le fermage est payé en euros.
Loyer des bâtiments d’habitation : si le bail comprend en plus des terres un logement d’habitation (par exemple, la maison de ferme dans laquelle vit le preneur), cette partie du loyer est également réglementée. Le préfet fixe des minima et maxima spécifiques pour les bâtiments d’habitation rurale, en général sur la base du nombre de pièces ou de la superficie du logement. Ces limites évoluent chaque année selon l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE (et non selon l’indice des fermages agricole). En pratique, le bail distingue donc le fermage des terres et bâtiments d’exploitation d’une part, et le loyer du bâtiment d’habitation d’autre part, avec des règles d’indexation différentes.
Révision du fermage : au cours du bail, le montant du fermage peut être révisé périodiquement pour rester dans les limites légales. L’indexation annuelle via l’indice des fermages se fait généralement automatiquement. En outre, deux principales hypothèses de révision exceptionnelle sont prévues par le Code rural :
-
Nouvel arrêté préfectoral : si un nouvel arrêté modifie les montants minimum ou maximum applicables (par exemple, une refonte du barème des fermages), chaque partie peut demander une révision du loyer en conséquence. Si bailleur et preneur ne parviennent pas à un accord amiable sur le nouveau montant, ils peuvent saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux, qui tranchera et fixera le loyer dans la fourchette actualisée.
-
Écart de plus de 10 % avec la valeur locative réelle : si, en cours de bail, le loyer payé s’écarte d’au moins 10 % de la valeur locative moyenne des terres louées (par exemple si le fermage est devenu 15 % plus élevé que la normale, ou au contraire nettement inférieur au prix du marché encadré), l’une ou l’autre des parties peut engager une action en révision devant le tribunal Le juge, après expertise, pourra augmenter ou diminuer le fermage pour le ramener à une valeur équitable dans les limites légales.
À ces cas de figure s’ajoutent des situations particulières où un supplément de loyer peut être accordé au bailleur, notamment s’il a réalisé des investissements qui profitent au preneur au-delà de ses obligations légales (par exemple, le propriétaire fait à ses frais un important drainage améliorant nettement les rendements : il pourrait négocier une majoration du fermage). Ces ajustements restent exceptionnels et très encadrés.
Modalités de paiement : le fermage se paye en principe à terme échu, c’est-à-dire une fois que la période d’exploitation est réalisée. Les échéances de paiement sont fixées dans le bail. Fréquemment, le loyer est payable annuellement (par exemple chaque fin d’année agricole). Parfois, surtout pour les gros fermages, le bail prévoit un paiement semestriel (deux fois par an) ou trimestriel. Les usages locaux peuvent influencer ces périodicités. Le règlement s’effectue en argent (chèque, virement bancaire, espèces dans la limite légale) ou en nature si cela a été convenu pour les baux en denrées. Le paiement en nature consiste par exemple à livrer au bailleur une certaine quantité de blé, de vin, d’huile, etc., chaque année à date fixe. Bailleur et preneur peuvent aussi convenir d’un endroit de paiement (domicile du bailleur, remise sur place, etc.), mais le plus souvent un virement bancaire simplifie les choses.
👉 En résumé : le montant du fermage est strictement encadré. Il doit s’inscrire entre un minimum et un maximum fixés par le préfet dans le département. Chaque année, un indice national vient faire varier ces limites, permettant de facto l’indexation annuelle des loyers agricoles. Le loyer des terres et bâtiments d’exploitation se revalorise selon l’indice des fermages, tandis que la part correspondant à un logement se revalorise selon l’IRL de l’INSEE. En cours de bail, des révisions ponctuelles sont possibles si les conditions l’exigent (changement des barèmes ou écart de plus de 10 % par rapport à la valeur locative). En pratique, bailleur et preneur doivent donc vérifier à la signature que le fermage convenu respecte le barème préfectoral, puis ajuster ce loyer chaque année suivant l’indice officiel.
Conclusion
Le bail rural est un outil juridique essentiel pour organiser la location de terres agricoles en France. Il crée une relation durable entre un propriétaire foncier et un exploitant, avec des droits et obligations équilibrés : stabilité de l’exploitation pendant au moins 9 ans pour le fermier, garantie de perception d’un fermage pour le propriétaire, et préservation du patrimoine rural en bon état. Pour les agriculteurs et les particuliers bailleurs, il est important d’en connaître les règles principales – qui peut signer, sous quelle forme, pour combien de temps et à quel loyer – afin de sécuriser la transmission temporaire des terres dans les meilleures conditions. Nous espérons que cet article vous aura aidé à y voir plus clair sur le bail à ferme. N’hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre d’agriculture ou d’un conseiller juridique rural pour toute question spécifique : mieux vaut prévenir que guérir, et un bail bien rédigé et bien compris est la clé d’une relation sereine entre bailleur et preneur sur le long terme.
Par Me Jérémy AUTHIER
Partager
Le droit de préemption de la SAFER est l’un des piliers du droit rural français.Il permet, dans certaines situations prévues par la loi, à la SAFER de se substituer à [...]